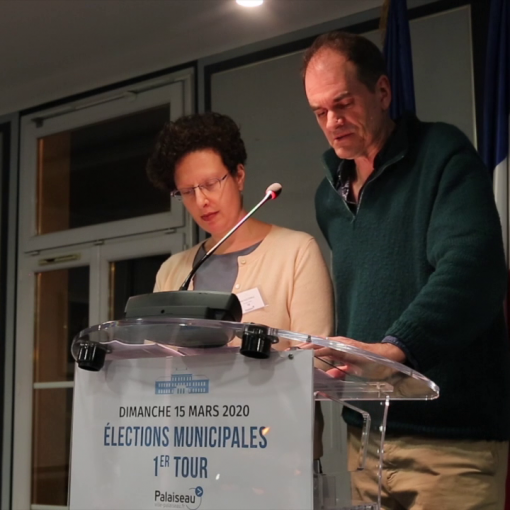Sur le projet de réforme des retraites « La Conviviale » vous propose l’analyse d’un de ses membres Jean-Claude Rouher.

Par ailleurs « La Conviviale » vous invite à participer au mouvement contre la réforme des retraites et à faire un don aux différentes caisses de grèves (quelques liens):
L’urgence à réformer les retraites n’est peut être pas celle qu’on croit.
Que penser du passage du système actuel à un dispositif où chacun, tout au long de sa vie, acquiert des points, convertis au moment de son départ en retraite ?
« Il y a urgence à réformer un système à bout de souffle ». nous dit-on. Est-ce si sûr ?
Le rapport du COR est éclairant :
« Au début des années 1990, [le poids des pensions dans le PIB] était de l’ordre de 11% et, sans réformes, était appelé à s’élever à environ 21% à l’horizon 2060. Les réformes passées ont ainsi permis de contenir la progression des dépenses. A l’horizon 2070, la part des dépenses brutes de retraites resterait inférieure à celle constatée dans trois scénarios, dans un contexte pourtant marqué par une évolution défavorable du ratio démographique ; Elles varieraient entre 11.6% et 14.4% du PIB selon les hypothèses » »
Ainsi, l’impact du papy boom est bien une réalité mais il est largement derrière nous et les réformes déjà réalisées suffisent à tenir la part des retraites sous la barre des 14% du PIB, aujourd’hui, et durant les années à venir.
Autrement dit, s’il y a urgence à réformer le système des retraites, ce n’est pas pour faire face à des difficultés à venir mais parce que celles-ci sont largement derrière nous. Ainsi, d’années en années il deviendra de plus en plus difficile d’alarmer les populations. C’est maintenant le moment où il est encore possible d’inquiéter l’opinion publique et de mettre en place le système à points proposé. Ce dernier présente dans une vision néolibérale un avantage majeur : Il permet de « piloter » le montant des retraites, c’est à dire en réduire le poids dans le PIB avec quelques leviers simples, notamment la valeur du point (voir la déclaration de François Fillon « l’avantage d’un système par points, c’est qu’il permet de faire baisser les retraites, mais ça, aucun gouvernement n’aura le courage de le dire »)
Voici la logique de la réforme systémique : mettre en place – c’est le moment – un régime de retraite doté de leviers simples pour ramener – à terme – le système par répartition à un dispositif à la main de l’Etat (cela a été fait en 1995 pour la Santé) destiné aux laissés pour compte et ouvrir l’accès aux régimes par capitalisation aux « insiders » insérés dans la mondialisation. S’il était nécessaire d’insister, l’idée est d’offrir un nouveau terrain de jeu à la bancassurance qui pourra proposer de nouveaux produits d’épargne retraite.
Avant de conclure, un mot sur « la période de transition » analysée par Henri Sterdyniak
« Le pire dans les propositions actuelles du gouvernement est de briser le fondement de la solidarité intergénérationnelle du système. Les jeunes cotiseront à un régime spécifique qui devra reverser leurs cotisations à des régimes dont les jeunes eux-mêmes ne bénéficieront jamais. Dans le système actuel, les cotisants savent que les décisions qu’ils prennent en matière de recettes et de dépenses les affectent eux-mêmes à court terme (les cotisations) ou à long terme (les conditions de départ, le montant des retraites). A partir de 2025, cette logique sera de plus en plus brisée de sorte qu’un conflit sera potentiellement créé entre les anciens (qui voudront maintenir des règles relativement satisfaisantes pour eux) et les jeunes (qui ne seront pas concernés par ces règles, mais par celles de leur système à venir)
Édouard Philippe prétend vouloir sauver le système français de répartition, mais sa réforme aboutirait à le fragmenter et à le fragiliser pendant longtemps, à faire que pendant de longues années les régimes qui verseront effectivement des prestations seront structurellement déficitaires. En reculant la date où la réforme s’appliquera, le gouvernement se trouve devoir imaginer une période de transition impossible à gérer »
A travers la question de la période de transition, on voit comment la défiance intuitive des jeunes envers les dispositifs de retraite viendra à se concrétiser.
Il est temps de conclure et, pour cela, de déconstruire un des éléments de langage répété à l’envi « le montant de la retraite ne pourra être inférieur à 1000€ »
Quid d’un salarié à carrière complète au SMIC ?
Là aussi, le rapport du COR fournit des éléments utiles :
« Cette projection montre un risque de dégradation réelle de la situation de ces personnes. Ainsi … leur taux de remplacement net à l’issue de la carrière pourrait chuter entre 67% et 75% de leur revenu à la liquidation. .. Une telle situation, qui pourrait signifier une paupérisation des personnes concernées, appelle une vigilance particulière…
… La comparaison entre la pension nette perçue par un salarié à l’issue d’une carrière cotisée au SMIC et le montant minimum vieillesse … illustre la possibilité que le montant du minimum vieillesse puisse à terme (à compter des générations de la fin des années 60) devenir supérieur à celui de la pension nette d’un salarié au SMIC »
Autrement dit, 1000 € pour une carrière complète, n’est pas « une révolution sociale » mais rien d’autre que le minimum vieillesse ; Cet exemple, et il y en a d’autres, montre le mécanisme utilisé pour « vendre » le projet : présenter comme une « avancée » ce qui n’est qu’un élément imposé par ailleurs ou pire, la compensation d’un effet négatif du dispositif (les femmes, les précaires, les carrières hachées .. ?).
Le cas des 1000€ est important car de plus en plus de retraités seront concernés puisque l’objectif est de diminuer le poids des retraites dans le PIB et, comme si cela ne suffisait pas, de résorber un éventuel déficit créé très largement par l’Etat lui-même par les exonérations de cotisations non compensées et par la réduction du nombre de fonctionnaires (C’est pour cela entre autres qu’a été ajouté au dispositif par points le fameux « âge pivot ».
La conclusion sur la réforme des retraites revient à Nicolas Castel :
« L’enjeu, pour le gouvernement, est d’assurer un filet de sécurité pour « les derniers de cordée » et d’opérer une contre-révolution sociale en mettant en place un système à trois piliers très inégalitaires : une pension minimale garantie pour les plus pauvres ; une pension en points pilotable à la baisse pour les cotisants, et une épargne retraite individuelle pour les plus riches »
Une ultime remarque : toutes les réformes engagées par le gouvernement vont dans le même sens : le code du travail rendu moins protecteur, l’assurance chômage révisée à la baisse (« une tuerie » selon Laurent Berger), la loi PACTE qui favorise les produits de retraite par capitalisation et pour finir la réforme des retraites, sans compter la diminution du nombre de fonctionnaires (à venir).
Pour comprendre la logique à l’œuvre, il suffit d’écouter E.Macron : « il faut que le travail paye ». Inversons la proposition : « il faut que toute autre forme de revenu liée au travail, assurance chômage, retraite … ne paye pas ».
Toutes les réformes passées et à venir vont dans le même sens.
La retraite par points aboutirait à une baisse des pensions (c’est le but). Cela concerne autant le privé que le public et notamment les agents de la fonction territoriale.
Exemples de pays ayant opté pour la retraite à points :
La Suède a vu entre 2004 et 2018, la pension de base garantie diminuer de 34% à 21% du salaire moyen et de plus en plus de retraités y sont contraints de continuer à travailler (38% des 67 ans ont un revenu provenant d’un salaire, contre 18% en 2000).
En Allemagne, Le montant moyen des pensions mensuelles à l’Ouest est de 864 €. Face au risque de paupérisation accrue des séniors, le pays est contraint de mettre en place un plancher (Grundrente) : 1 250 euros pour un célibataire (pour 35 ans de cotisations soit un niveau beaucoup plus généreux que les 85 % du salaire minimum promis par le gouvernement français.
Partout en Europe, les politiques néo libérales viennent grossir le nombre des laissés pour compte. Le risque est grand de voir l’échelon de base qu’est la commune, obligé de palier vaille que vaille le manque de ressources des plus démunis.
par Jean-Claude Rouher.
Sources : 5e rapport du COR et les analyses d’Hervé Lebras (démographe), Henri Sterdyniak (membre des économistes atterrés) et Nicolas Castel (sociologue).
: